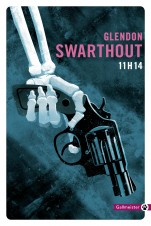Située aux antipodes, l’île de Tasmanie n’est pas un territoire dont la mention fait entrer en émulsion un lectorat féru en géographie. À vrai dire, le nom évoque davantage un trouble obsessionnel du comportement qu’un toponyme. Ce petit bout d’Australie, grand comme sept fois la Corse quand même, n’en demeure pas moins le cadre du roman de Rohan Wilson.
Murmurer le nom des disparus n’a rien à envier au roman noir américain ou au Western dont il partage bien des caractères, si l’on fait abstraction des aborigènes, kangourous et autres marsupiaux de tous poils. Pas difficile de le faire d’ailleurs, puisque l’auteur choisit de se focaliser sur l’humain et sa désespérante condition. Sur fond d’émeute, de révolte contre l’impôt, de misère et de violence, Murmurer le nom des disparus raconte ainsi l’histoire d’un père et d’un fils. Un père absent, brutal, alcoolique notoire et criminel, parti chercher l’aventure ailleurs plutôt que d’entretenir une relation toxique vouée à l’échec. Un fils contraint de grandir prématurément après la mort subite de sa mère, obligé de tricher avec les autorités afin d’assumer sa subsistance seul et éviter ainsi le placement dans un hospice.
Récit âpre et sans concession, Murmurer le nom des disparus n’évite pas l’écueil du classicisme, même s’il tente de faire revivre une page oubliée de l’histoire de la Tasmanie. Les ressorts de l’intrigue flirte avec le déjà-vu, mais le récit sonne juste, brassant la thématique de la rédemption. Course-poursuite impitoyable, guidée autant par la volonté de se faire justice soi-même que par la quête d’une vraie justice, à la fois sociale et morale, le roman de Rohan Wilson se distingue également par sa tonalité désabusée. L’auteur dresse ainsi le portrait d’un pays n’ayant rien à envier à l’Ouest américain, une contrée exposée aux convoitises, à la loi du plus fort et une conception rudimentaire de l’application de la justice. On y considère les Aborigènes comme des parasites, des sauvages dont il convient de purger la terre afin de laisser place à la colonisation et à une exploitation plu conforme au progrès. On utilise les bagnards comme une main-d’œuvre gratuite, histoire de leur apprendre à rester à leur place, les lois expéditives pourvoyant à leur renouvellement incessant. Bref, on ne s’embarrasse pas avec un humanisme jugé superflu, préférant les vertus rugueuses d’un struggle for life impitoyable.
La quatrième de couverture évoque Cormac McCarthy, établissant un parallèle entre le présent roman et l’œuvre de l’auteur américain. Si la Tasmanie de Rohan Wilson semble irrémédiablement souillée par le péché, en proie à une corruption des mœurs épouvantable, un mal antédiluvien entachant une nature humaine définitivement imparfaite, on n’atteint cependant pas la puissance d’évocation de Méridien de Sang.
En dépit de ce léger bémol, Murmurer le nom des disparus recèle suffisamment de tension et de descriptions saisissantes pour happer le lecteur et satisfaire ses attentes en matière d’émotion. Voici assurément un auteur à découvrir.
Murmurer le nom des disparus (To Name Those Lost, 2014) – Rohan Wilson – Éditions Albin Michel, collection « Les Grandes traductions », novembre 2021 (roman traduit de l’anglais [Australie] par Étienne Gomez)